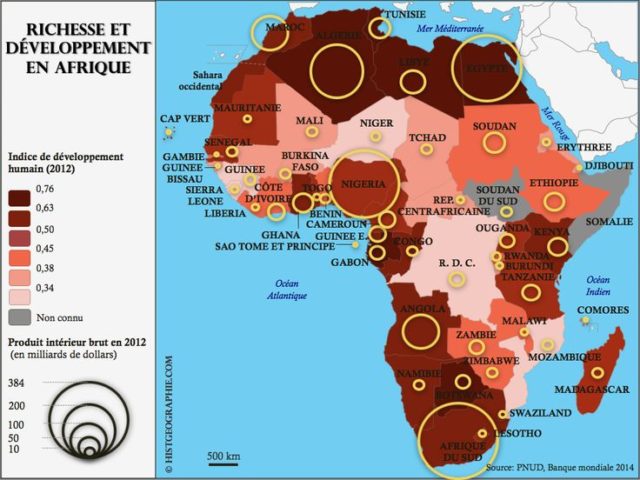Le domaine des questions relatives au développement tient de ce que le malicieux Karl Popper nommait le sublunaire. C’est-à-dire des choses qui se voient pratiquement à l’œil nu. Il s’agit en quelque sorte de se demander : comment les autres ont-ils fait ? Alors, on peut répondre allègrement – avec le grand historien anglais Arnold Toynbee – que les nations se mettent sur orbite à coups de réponses apportées à des défis que la nature ou les épreuves opposent à la volonté des hommes. Et leur avenir dépend à chaque fois d’une minorité d’individus créateurs. Ainsi, on peut recenser quelques défis auxquels l’Afrique d’aujourd’hui est confrontée.
Mais avant, il faut noter que le développement c’est « la combinaison des changements mentaux et sociaux d’une population qui la rendent apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global ». Il se manifeste par une hausse du revenu par tête, un accroissement de la ration alimentaire, un meilleur accès des populations aux services de santé et d’éducation ; aussi par la qualité de la main-d’œuvre, la complexité de l’organisation de la production, des modifications notables dans les comportements des individus. Bref, le développement implique une mutation de la société dans son ensemble. Les besoins humains sont mieux satisfaits, parce que le système productif est plus efficace. Il n’y a pas de voie royale. Cependant, il existe assurément des chemins qui doivent être empruntés, si une nation veut élargir les possibilités de réussite qu’elle offre à ses ressortissants « qui ont le désir d’échapper à l’équilibre de la pauvreté de masse et à sa culture ».
- La culture fait la différence
La culture, au sens des valeurs et des comportements qui guident une population, est un sujet presque tabou chez les chercheurs. Notamment parce que son examen, surtout s’il est le fait d’un étranger, met en danger l’ego le plus profond du groupe, blesse son identité et son estime de soi. Pourtant Max Weber avait eu raison de s’en soucier. Opter pour le développement peut-être coûteux culturellement. On ne saurait créer une main-d’œuvre qualifiée et disponible, une société industrialisée en état de marche, sans sacrifier certaines pratiques sociales : la corruption, la déloyauté, la confusion des affaires publiques et privées. Il faut renoncer à une bonne part des divertissements, à l’anarchie sympathique qui règne dans les relations personnelles ; il faut souscrire à la culture de l’effort, de la discipline et du sacrifice de soi. Bien qu’il ne soit pas aisé de mesurer l’impact du capital social et du capital culturel sur la réussite d’un pays, l’observation empirique laisse percevoir des différences de taux de croissance économique entre les nations où des valeurs telles que la confiance, la loyauté, le parler vrai sont pratiquées et les autres. Oui : la prospérité et le développement sont affaires de culture. Tout au long de l’histoire, les sociétés qui ont prospéré se sont appuyées sur une culture consciente de ses fondements, et capable d’imaginer son futur. Et toujours, le travail y a été consacré comme la principale source de l’enrichissement collectif ; et la volonté de dominer la nature un impératif. Le développement de l’Afrique passera, lui aussi, par une refondation de sa culture.
- Le capital, c’est le savoir
« Bien que la nature soit sujette à des rendements décroissants, l’homme est sujet aux rendements croissants. […] Le savoir est le principal moteur de la production, c’est lui qui nous permet de soumettre la nature et de satisfaire nos désirs . » La Banque mondiale rappelle dans son Rapport sur le développement dans le monde, que les idées sont des facteurs productifs de la toute première importance : « Les pays pauvres – et les individus pauvres – sont différents des riches non seulement parce qu’ils disposent d’un capital inférieur, mais également parce qu’ils jouissent de moins de savoir. » L’enjeu du savoir n’est pas simplement lié au développement, il s’agit également d’une question de souveraineté et de dignité nationale. Bonaventure Mvé-Ondo avance que, « toute société qui ne produit pas du savoir scientifique et des objets techniques, fût-elle installée sur des puits de pétrole, est appelée à disparaître ». On ne peut guère échapper à la domination si l’on demeure le consommateur des connaissances scientifiques et des innovations techniques élaborées par les autres. L’Afrique ne se développera que si elle fait la greffe de la science – y compris et d’abord les sciences humaines et sociales – à sa culture. Elle doit résolument tourner le dos à une conception qui fait de la science « la chose du Blanc », tout en important massivement les produits de la science et de la technique. Depuis toujours, la source fondamentale de l’amélioration du bien-être humain est l’augmentation du stock de connaissances. Et après le capital, qu’est-ce que la richesse alors ? « Être riche, c’est avoir l’éducation, les compétences, la technologie. Être riche, c’est savoir. » C’est ce que dit un banquier d’affaires du golfe Persique, pour conclure que les Saoudiens ne sont pas riches, puisqu’ils importent tout !
III. Il faut créer une matrice institutionnelle flexible
Les hommes ont besoin de comprendre leur environnement avant de le changer. Cet environnement est tout à la fois physique, matériel et symbolique – les croyances, les mythes, les modes d’actions qui constituent sa culture. C’est pour affronter l’incertitude que les hommes et les sociétés font naître ces « cadres mentaux », qui finalement produisent certaines institutions sociales et politiques. Le but de celles-ci étant de structurer l’environnement dans lequel ils vivent, afin d’en accroître la prévisibilité. Douglas North appelle le noyau de ces croyances et de ces institutions qui permettent à un pays de fonctionner, sa matrice institutionnelle. Elle peut être de nature à favoriser le développement, ou à la bloquer. Ces croyances, ces mythes, ces règles formelles et les moyens de les faire respecter agissent comme des espèces d’échafaudages, qui peuvent faciliter ou freiner le changement dans une société. Tant que le système d’incitations de cette matrice institutionnelle est favorable aux agents, le développement est possible ; sinon la société ne progresse pas. C’est de ses arrangements institutionnels et de ses organisations que dépend la performance économique d’un pays. A ce sujet, Karla Hoff et Joseph E. Stieglitz disent : « On ne conçoit plus le développement comme étant principalement un processus d’accumulation du capital, mais plutôt comme un processus de changement organisationnel. » Le succès d’un pays comme les Etats-Unis, depuis trois siècles, est fondé sur l’existence d’une matrice institutionnelle souple, qui s’adapte en permanence pour résoudre les problèmes liés au changement. Le changement – premier pas du développement – est empêché en Afrique par la rigidité et le conservatisme de sa matrice institutionnelle. Celle-ci est « hantée par le non savoir, la religion et la sorcellerie ».
- Il faut libérer l’homme économique
On sait ce que l’essor de l’Occident doit à la Réforme de Calvin : tout ce qui fait le propre de l’homme est désormais assumé en conscience, en confiance. Calvin appelle les hommes à faire fructifier tous les dons de Dieu, y compris donc celui de faire de l’argent. Avec lui, la mentalité économique se déplace du partage des richesses vers sa création ; puisque l’échange des produits est intrinsèquement productif. C’est de là que l’expression « Tu seras marchand, mon fils ! » a connu une certaine gloire en Europe. De même que toute une doctrine visant à préserver le commerce de la « force du mépris ». Ses promoteurs décelaient dans sa pratique un certain nombre de vertus sociales : la probité, la prudence et la loyauté. Il est vrai que de longue date, les libéraux placent le commerce plutôt au centre du système. Pour eux, il ne s’agit pas d’un secteur d’activité parmi d’autres.
Il faut permettre l’épanouissement de l’homme économique, parce que la liberté économique est constitutive de la liberté humaine. Montesquieu observe d’ailleurs que partout où il y a commerce il y a des mœurs douces, et vice versa. Il voit le commerçant comme un humaniste pratique, une sorte de citoyen avant la lettre. Un homme qui fournit à la société trois bonnes choses : la connaissance, l’art de la comparaison et des biens. D’ailleurs, pour Amartya K. Sen : « La liberté n’est pas seulement le but ultime du développement : elle en est aussi un moyen déterminant et fondamental. » Sur le plan opérationnel de la dynamique du développement, Douglass North offre une lecture particulièrement stimulante. Un nombre encore trop important des échanges qui ont lieu entre les agents en Afrique sont des échanges personnalisés, héritages de temps où les incertitudes étaient celles de l’environnement physique. Pour développer leur pays, les hommes doivent passer à des sociétés dominées par les incertitudes liées à l’humain. Dans ces sociétés-là, les échanges sont impersonnels ; ce sont les échanges de marché. Et « l’échange impersonnel a besoin d’un certain nombre d’institutions politiques, sociales et économiques qui « violent » les prédispositions génétiques innées apparues au cours des millions d’années qu’ont duré les régimes de chasse et de cueillette . » Autrement dit, la confrontation des agents économiques sur des marchés de plus en plus nombreux, enrichit la nation et libère les activités humaines d’une logique forcément « clientéliste », parce que purement personnelle.
La société n’est pas « naturellement » libérale ; la liberté n’est pas obligée. Les droits de propriété doivent être garantis, si l’on veut s’inscrire dans une perspective progressiste. Car la propriété est l’autre nom de la liberté ; une liberté primordiale, une motivation pour l’activité humaine. Il y a un moteur encore plus important que la propriété, c’est le processus de l’appropriation. Frédéric Bastiat voit dans l’intérêt personnel et l’amour du développement, le grand ressort de l’humanité. « L’appropriation est un phénomène naturel, providentiel, essentiel à la vie, et la propriété n’est que l’appropriation devenue un droit par le travail . » Les économistes contemporains sont unanimes pour dire que des droits de propriété sûrs et applicables sont ce qu’il y a de plus décisif à la vie économique. Ils donnent confiance aux agents, surtout aux investisseurs étrangers ; ils canalisent les capitaux vers des activités productives, donc ils favorisent la croissance du revenu. Or dans la plupart des pays africains, les droits de la propriété sont souvent définis de manière informelle, issus de la coutume, et insuffisamment appliqués. Cela est préjudiciable à la confiance et à l’investissement. C’est vrai que la bataille pour définir les droits de la propriété et leur donner un cadre légal solide est une entreprise de longue haleine. Pourtant, dans le contexte de l’économie mondialisée, où les marchés nationaux sont extrêmement concurrentiels, l’engagement de cette campagne ne saurait plus attendre.
- Il faut endiguer l’emprise de l’Etat et du politique
Même s’il est vrai que c’est le politique qui définit et fait appliquer les règles formelles du jeu économique, grâce à la puissance de l’Etat, il faut veiller à ce que celui-ci ne devienne pas « la grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde. » La croissance économique sur une longue période, tout comme l’instauration et la survie de la diversité des conditions dans la société, sont tributaires de la puissance publique. L’ordre est nécessaire, l’Etat est indispensable. Mais il faut disposer d’« une structure sous-jacente qui oblige l’Etat de manière crédible envers un ensemble de règles politiques et de moyens assurant la protection des organisations et des relations d’échange ». Le développement n’est possible que si les citoyens se protègent d’une certaine manière de la tendance tentaculaire du Pouvoir. Encore une fois, l’Etat est utile. Surtout dans les premières phases de la lutte pour la compétitivité du pays, où les interventions gouvernementales peuvent s’avérer décisives. N’empêche que, trop puissant le Pouvoir se transforme vite en entrave à la vitalité de la société. D’où la pertinence toujours actuelle de l’invitation de Hegel à fonder la construction de la société sur la Raison, c’est-à-dire l’intelligence humaine ne comptant que sur elle-même.
- Il faut poser la question démographique
On sait depuis longtemps que les performances économiques et sociales des pays sont déterminées par le jeu complexe de leur démographie, de leur stock de connaissances et de leurs institutions. Mais on insiste rarement sur la première composante de ce triptyque, la question démographique. Comme si le mot de Jean Bodin, « il n’est de force ni de richesse que d’hommes », avait tétanisé des générations et des générations de démographes et d’économistes. L’homme joue un double rôle dans le phénomène du développement : d’un côté il en est le bénéficiaire, de l’autre il constitue le principal facteur de production. Cela étant, une croissance non maîtrisée de la population – comme c’est généralement le cas en Afrique – constitue un véritable obstacle au développement.
Il existe de vraies logiques sociologiques derrière la forte natalité observable dans les sociétés africaines, qu’il reste encore à élucider. La réflexion doit s’ouvrir sur cette question fondamentale. Car il n’y a pas de développement tant que n’a pas été réglée la transition démographique – le moment où les taux de natalité et de mortalité infantile baissent de façon significative, avec un solde positif pour l’accroissement de la population, par exemple l’Europe des 18e et 19e siècles. Il est à noter que la thèse fameuse du pasteur Malthus, selon laquelle la croissance démographique bloque l’accroissement des ressources disponibles par tête, a été largement rejetée par l’expérience européenne mais validée dans le contexte actuel des pays d’Afrique. A tel point que René Dumont a pu parler à propos de l’Afrique du « triomphe de Malthus » !
 Par Raoul Nkuitchou Nkouatchet,
Par Raoul Nkuitchou Nkouatchet,
Président du Cercle Mont Cameroun, Paris